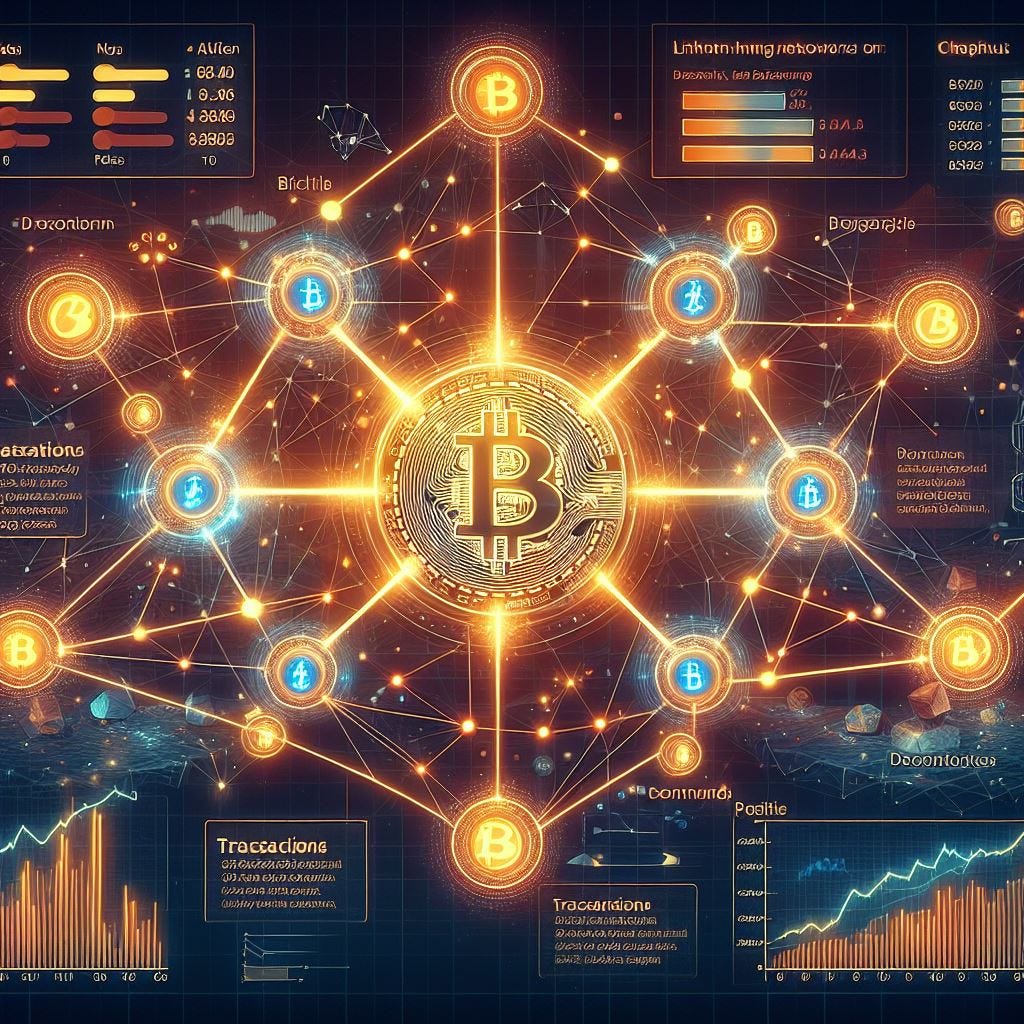Le solidus d'or, une monnaie saine pour sauver l’Empire
Dernier article sur notre série consacrée à la monnaie romaine. Au quatrième siècle un Empereur, Constantin, tente de sauver l'économie de l'Empire en introduisant une monnaie : le Solidus d'or
Dans d’autres articles nous avons fait le point sur la crise du troisième siècle et comment la monnaie a été détruite au long des années par les politiques inflationnistes des empereurs romain. À la fin du troisième siècle, Dioclétien (284 - 305) tente sans succès une réforme monétaire de l’Empire couplée à des dépenses publiques importantes afin de redresser une économie romaine moribonde. Sa tentative est doublement un échec. Sa réforme de la monnaie est un fiasco et ses projets impliquant d'énormes dépenses publiques font exploser l’inflation (jusqu’à 35% sur l’année 301). À la fin de son règne commence de nouvelles luttes pour le pouvoir jusqu’à l’ascension de l’empereur Constantin (310 - 337) à la tête de l’Empire.
Figure importante à plus d’un titre pour les historiens, Constantin entreprend en 310 une réforme monétaire essentielle : l’introduction du solidus d’or comme monnaie de référence de l’Empire. Composée de 4.55 grammes d’or pur, cette monnaie aura une stabilité prodigieuse qui va survivre à l'Empire romain d’Occident pendant sept siècles. Il sera ensuite utilisé par les Wisigoths et les Francs en Europe (le mot français “sou” étant un ancien diminutif de solidus). À l’est, il sera utilisé jusqu’au XIème par l’Empire Byzantin, unique héritier direct de l’Empire romain.
Le solidus d’or, une monnaie très contrôlée par l’administration
Remplaçant le monnayage d’argent comme colonne vertébrale du système monétaire romain, le solidus d’or va procurer un répit bienvenu, mais momentané, à l’Empire. La clé ? Un contrôle strict du poids des pièces d’or en circulation dans l’économie par des fonctionnaires contrôleurs dans chaque grande ville de l'Empire. La garantie du poids du solidus est économiquement nécessaire, car elle est tout d’abord menacée par l'usure naturelle des pièces causée par leur circulation, mais aussi par les fraudes au limage ou au rognage, consistant à prélever un peu d'or sur chaque pièce, ou encore par des falsifications de faux solidus plus légers frappés illégalement.
Souhaitant ne pas répéter les erreurs du passé, l’administration prélève l’impôt uniquement en or afin de stabiliser le trésor impérial et n’émet que très ponctuellement des nouvelles unités monétaires, uniquement quand ses réserves d’or le lui permettent. Le solidus présente malgré tout deux limites de taille qui l’empêche de stabiliser durablement l’économie romaine.
Les limites du Solidus, divisibilité et échangeabilité
Première limite, il est difficilement échangeable et divisible pour être efficacement utilisé comme intermédiaire d’échange. À son introduction, sa valeur faciale équivaut à 275.000 anciens denarius (comprenant 5% d’argent). En 370, une tentative est faite pour rendre le solidus plus liquide avec la création de deux nouvelles pièces d’or : le semis (½ d’un solidus) et le triens (⅓ d’un solidus), mais cela ne règlera pas le problème.
Seconde limite, cet étalon-or romain est utilisé en parallèle de nouvelles monnaies de bronze et d’argent qui viennent fournir une monnaie plus liquide pour les dépenses du quotidien des citoyens. Contrairement au solidus ces monnaies ne sont pas contrôlées par l’administration et sont émises massivement et sans contrôle par les ateliers de frappe monétaire. Les vieilles habitudes inflationnistes reviennent donc, et comme pour la période précédente, le lien entre inflation monétaire, dévaluation de la monnaie et hausse des prix échappe totalement aux gouvernants romains. La valeur de la monnaie de bronze, le nummus, baisse ainsi continuellement jusqu'à la disparition de l'Empire. En 445, un solidus vaut 7 200 nummus, en 498 il en vaut 16 800.
Cette inflation de la masse monétaire des pièces de bronze rend le solidus de plus en plus fort pour l’économie réelle, l'éloignant ainsi sans cesse de son rôle initial de monnaie d’échange. Malgré ce décrochage, le solidus reste l’unité de compte, la référence en termes de mesure de la valeur, par excellence dans l’Empire. Il devient le seul moyen fiable d'exprimer les prix, l’impôt, les dépenses et les dettes en se protégeant d’éventuelles dépréciations. Il est également la seule réserve de valeur de confiance pour thésauriser l’épargne face aux incertitudes inhérentes au futur. À mesure que l’inflation fait baisser la valeur des autres monnaies, un fossé se creuse aussi de plus en plus entre les citoyens aisés et les citoyens pauvres de l’Empire. Entre ceux pouvant avoir accès au solidus, et à ses sous-multiples, le semis et le triens, et le reste de la population.
Solidus vs Nummus, deux monnaies bien différentes dans une seule économie
Les deux faiblesses majeures du solidus, son manque de divisibilité et d’échangeabilité, vont restreindre malgré tout son impact. Ce sont les monnaies comme le nummus qui rempliront pleinement la fonction nécessaire de monnaie d’échange, non le solidus. Ce système à double monnaie partait sur des mauvaises bases tellement les deux monnaies ne suivaient pas les mêmes logiques monétaires.
La mise en place de taux de change fixes entre le nummus et le solidus était rendue impossible du fait des valeurs trop disparates entre les deux monnaies. Ce contrôle des prix des monnaies (même si questionnable) aurait pu stabiliser la situation en empêchant par exemple au monnayage de bronze d’être frappé ad nauseam (“à n’en plus finir”) et sans contrôle. Les régimes d’émission trop différents entre le nummus et le solidus empêche également l’introduction de cours flottants venant harmoniser naturellement le cours entre ces deux monnaies.
La coexistence de plusieurs monnaies ayant cours légal dans une même économie, sans taux de change fixe et de régime d'émission cohérent entre elles, l’une étant fortement inflationniste et l’autre très faiblement inflationniste, va empêcher au système monétaire romain de s’ancrer réellement sur la valeur stable du solidus et de l'or.
En somme, l’introduction du solidus d’or en 310 avait pour but de stabiliser la monnaie et l’économie romaine suite à des décennies d’inflations monétaires désastreuses en introduisant une monnaie dure, faiblement inflationniste et soumise à un contrôle strict de son poids en or. Malgré la concurrence du nummus, le solidus a réussi donné à l’Empire une unité de compte et une réserve de valeur efficace qui, fait unique dans l’histoire, va survivre 700 ans après la fin de l’Empire d’occident.
Quelle leçon pour aujourd’hui ?
Que retenir de cette expérience romaine et des limites du solidus d’or ? L'introduction d’une monnaie dure dans le but de redresser la situation monétaire désastreuse de l’Empire a certainement été la bonne intuition, mais celle-ci n’a finalement pas réussi à remplir sa fonction principale essentielle, être une marchandise facilement échangeable et divisible. Plusieurs siècles plus tard, ce problème de liquidité inhérent à l’or sera réglé par l’introduction de la monnaie papier, mettant un terme définitif aux systèmes monétaires bimétalliques et trimétalliques, mais introduira par la même occasion d’autres problématiques (cf article étalon or).
L’administration romaine n’avait pas connaissance de ces règles, contrairement à nos gouvernants actuels. Leur tentative de réintroduire un système monétaire sain n’a pas réussi à mettre un terme aux vieilles traditions inflationnistes de Rome. La monnaie, “le système nerveux du système économique” comme disait Rothbard, est toujours imparfaite et ne parvient pas à être un intermédiaire d’échange viable sur la durée. Les économistes de l’école autrichienne sont d'ailleurs assez clairs sur ce sujet, la monnaie se définit avant tout par sa capacité d’être un moyen d’échange avant d’être une unité de compte ou une réserve de valeur. Sans cette qualité première, pas de monnaie.
Aujourd’hui, nous savons analyser les effets néfastes des politiques inflationnistes sur la société et nous avons à disposition la monnaie la plus dure connue : Bitcoin. Sa grande divisibilité, 21 millions de bitcoins divisibles en 100 millions de satoshis chacun, résout le défaut de divisibilité qu’avait le solidus romain. Les technologies d’échange rapides en L2, comme le réseau Lightning, offriront à terme le moyen de rendre la monnaie facilement échangeable.
Deux avantages essentiels à toute monnaie que le solidus ne pouvait pas garantir à la population romaine. Bitcoin est déjà une réserve de valeur efficace comme l’était également le solidus. Le seul point restant à parfaire pour Bitcoin est sa capacité à être une mesure de la valeur efficace, une unité de compte fiable pour le calcul économique. Quand Bitcoin aura atteint un ratio d’échange stable avec plusieurs biens et marchandises sur la durée, comme si 1 pizza valait à tout moment 10.000 bitcoins. Cet objectif sera atteint, une solution : l’adoption.
Dans le cas d’une adoption de Bitcoin, ces qualités inhérentes au protocole rendent sa cohabitation avec une autre monnaie à priori inutile. Contrairement au solidus qui, dix-sept siècles plus tôt, cohabitait avec une monnaie inflationniste, le nummus. Mais cette question de plusieurs monnaies circulant concurremment dans une même économie est un sujet pour un autre article.